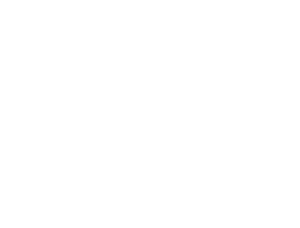25 September 2025
URMIS, Paris, 25 septembre 2025
Université Paris-Cité, place Paul Ricoeur, bâtiment Olympe de Gouges – Salle 105
Coordinatrices : Florence Boyer, Anne Doquet, Maud Laëthier
>> Télécharger le programme au format pdf
La fermeture des terrains de recherche et/ou les contraintes qui s’exercent sur la pratique du terrain commencent à occuper une place importante dans les débats institutionnels et scientifiques (en témoignent les initiatives récentes de l’INALCO et du CNRS[1]), voire dans le champ médiatique (publicisation des arrestations de chercheurs). L’étendue de la question montre qu’elle s’inscrit dans des contextes géopolitiques et politiques divers, touchant des espaces aux Nords comme aux Suds ; elle concerne non plus seulement des chercheurs qui travaille sur la/des violence/s ou des conflits, mais aussi des chercheurs engagés dans des thématiques plus « ordinaires ». Pour autant, nombreux sont les travaux qui, dans le passé, ont proposé et avancé des clés de compréhension méthodologique, épistémologique, susceptibles d’éclairer les catégorisations aussi larges que celles de terrains « empêchés », « contraints », « terrains à risque », « minés » ou « violents ».
La journée d’étude que nous organisons propose de revenir et d’approfondir la réflexion sur ces points. L’objectif est d’interroger cette question des terrains « entravés » dans ses manifestations plus ou moins récentes, en examinant plusieurs cas précis (tenant compte des singularités propres aux situations ethnographiques et historiques concernées). Partant d’une interrogation des usages institutionnels et des usages scientifiques de catégories/catégorisations indiquées, il s’agit de tenter d’en construire une approche critique, de saisir les eOets de réciprocité de ces usages de même que leur performativité/ l’incidence sur la production de connaissances, comme à regarder de plus près le devenir d’une recherche élaborée en partenariat. De là, dans une perspective à la fois comparative et pluridisciplinaire (anthropologie, géographie, science politique, sociologie, histoire), le questionnement s’oriente dans trois directions :
- TR : Construire une « recherche en sécurité » ou construire sa sécurité sur le terrain ?
- TR : Comment enquêter autour, à partir de, à distance ou entériner la fermeture d’un terrain de recherche ?
- TR : Dans quelle mesure l’entrave renouvelle-t-elle les formes d’investigation scientifique, et plus précisément la coproduction du savoir ?
Sous forme de tables rondes, le développement et le croisement de ces axes permettront de soulever des questions relevant aussi bien de l’accès aux terrains que de la liberté d’expression (liberté académique ; légitimer l’interdiction – et la comprendre – d’un terrain pour cause de « sécurité »). Cette journée permet aussi de dégager les contours et définir les contenus de stratégies afin de poursuivre des travaux sans être physiquement présent sur le terrain. L’idée est d’ailleurs de renouveler le dialogue entre chercheurs qui ont acquis et maitrisent cette « habitude » de travail et d’autres, se sentant davantage contraints de s’en accommoder. Enfin, cette journée est l’occasion d’un échange entre des acteurs de nos institutions (Direction du Département « Science et Société »), des chercheurs académiques des Nords et des Suds, et des chercheurs-experts. La question du partenariat reste en eOet toujours à interroger.
La recherche en partenariat croise la question du décolonial, que les terrains « empêchés » viennent travailler. Elle est propice à nourrir les méthodes de l’anthropologie participative ou collaborative, actuellement prônées par les institutions, qui visent à coproduire les savoirs en incluant le point de vue des enquêtés à toutes les étapes du travail. Elles impliquent aussi une attention et une renégociation des rapports de pouvoir au fil des programmes de recherche. La place prise par nos collègues, et au-delà nos interlocuteur-rices aux Suds, sur des terrains auxquels elles/eux-seul-es peuvent accéder pourrait donner lieu à de nouvelles formes de collaboration, voire à de nouveaux outils infléchissant la production scientifique. Outre un dialogue avec nos collègues et partenaires, est ainsi de nouveau posée la question des inégalités face aux risques de même que celle des formes de collaboration à distance et de leur pérennisation.
Table ronde : Construire une « recherche en sécurité » ou construire sa sécurité sur le terrain ?, coord. Anne Doquet (9h-10h45)
- Florence Boyer (IRD, URMIS)
- Évelyne Mesclier (IRD/SOC)
- Florence Padovani (Univ. Paris 1 – Panthéon Sorbonne)
- Camille Cassarini (IRMC)
Table ronde, Comment enquêter autour, à partir de, à distance ou entériner la fermeture d’un terrain de recherche ?, coord. Florence Boyer (11h15-12h45)
- Jean-Hervé Jezéquiel (CRISIS Group)
- Laura Ruiz de Elvira (IRD, CEPED)
- Julien Gavelle (Chercheur indépendant)
- Rémi Carayol (journaliste indépendant)
Table ronde Dans quelle mesure l’entrave renouvelle-t-elle les formes d’investigation scientifique, et plus précisément la coproduction du savoir et les partenariats ?, coord. Maud Laëthier (14h30-16h15)
- Picard Byron (Univ. d’État d’Haïti)
- Sabine Planel (IRD, IMAF)
- Mitiku Tesfaye Gabrehiwot (EHESS, IMAF)
- Abdelaziz Mohamed Musa Ishaq (Prog. PAUSE, URMIS)
- Lucie Revilla (CNRS, IMAF)
- Adam Bacsko (CNRS, CERI)
Synthèse (17h)
- William Berthomière (CNRS)
- Swanie Potot (CNRS, URMIS)
[1] L’Inalco a lancé en 2024 l’enquête internationale « Recherche, formation et expertise sur des terrains “empêchés” ou “entravés” : pratiques, méthodes, nouvelles ressources », suivie cette année de sessions de formation à la recherche sur ces terrains. Les GIS Asie, Gis Etudes africaines et GIS MOOM prévoient par ailleurs de livrer fin 2025-début 2026 un livre blanc sur les « terrains empêchés ».