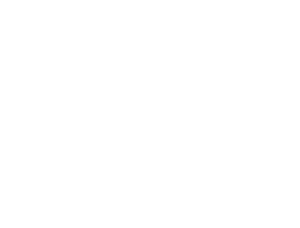11 septembre 2017
Journée d’étude : « Terrains interdits ? »
11 septembre 2017, Université Paris Diderot (organisée par le CESSMA, l’URMIS et la F3S)
Les pratiques de la recherche scientifique ne peuvent faire l’économie d’une démarche réflexive sur la construction du savoir et les conditions dans lesquelles celui-ci est élaboré. En sciences sociales, l’accès au terrain est la condition sine qua non d’une production historicisée et située de connaissances au plus près des transformations sociales. Un ensemble de restrictions affecte aujourd’hui, de façon inédite, la possibilité de mener librement un travail de recherche fondé sur une approche empirique des objets.
Sur la base d’un partage d’expériences, cette journée a visé à engager une réflexion sur les conséquences de ces restrictions et limitations (définies par les institutions ou des intérêts géostratégiques) autant dans le choix des objets que dans la production des connaissances. Les différentes communications (au nombre de 6) de cette journée ont cherché à refléter la diversité de recherches pour lesquelles la question de l’accès au terrain est posée.
On trouvera en annexe de ce document le texte qui avait servi d’appel à la journée, ainsi que le programme.
La première session a été l’occasion d’explorer les questions relatives à des contextes de violence, ceux-ci pouvant donner lieu à des interdictions de la part des institutions ou à des formes de censure, d’auto-restriction de la part du chercheur. Dans son intervention, intitulée « Perdre le Nord… du Mali sans couper les liens avec les gens qui y vivent. Retour sur cinq années de violences et de terrains interdits », Charles Grémont (IRD, LPED), historien, s’est attaché à retracer les évolutions de son travail de terrain dans le contexte du déclenchement du conflit malien en 2012 et du classement par le Ministère des Affaires étrangères français d’une grande partie du territoire malien en zone rouge ou orange avant même cette période.
C. Grémont indique la difficulté de mise en œuvre d’un travail de terrain au sens classique, entre limites d’autorisation, escorte militaire obligatoire et/ou contournement des normes et règles établies. Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre pour dépasser ces interdictions et contraintes. D’une part, la pratique d’un terrain dans la durée permet la construction d’un réseau de connaissances qui peut être mis à contribution dans ce type de contexte : reconnexion de réseaux via des rencontres à l’extérieur du Mali, connexion avec des membres de la diaspora ou des personnes installées dans les capitales (accessibles). Cependant, le passage par des intermédiaires n’est pas sans conséquence sur le statut des informations, et les biais, la frustration que cela peut créer chez le chercheur. C. Grémont met également en évidence le paradoxe dans lequel le chercheur se retrouve : alors que les institutions limitent, interdisent l’accès au terrain, celles-ci sont demandeuses d’informations, de grilles de lecture sur ces mêmes espaces dans une perspective de compréhension et de médiation des conflits. Le chercheur décrit alors des situations et des processus complexes, sans pour autant que les résultats de recherche puissent trouver écho dans les agendas et priorités des prescripteurs de cette demande d’expertise. Ce paradoxe dans les rapports entre pouvoirs publics et chercheurs est d’autant plus fort que le départ des chercheurs du terrain est souvent concomitant de l’arrivée des journalistes dans ces mêmes espaces et/ou la production d’un discours par des « experts » loin des réalités locales en cours, mais fortement sollicités par les milieux politiques et médiatiques. Dans le débat qui s’ensuit, il est fait remarquer que le problème de l’accessibilité est loin de se limiter aux chercheurs étrangers et aux règles édictées par leurs institutions : très souvent, les contraintes liées aux situations de violence sont aussi limitantes pour les chercheurs des institutions locales et nationales.
Complémentaire, l’intervention de Laurent Faret, géographe, a abordé des « Terrains mexicains en contexte de violence : migrants centraméricains dans l’espace métropolitain ». Il décrit les conditions de terrain dans une situation de violence, sans que l’accès à ces mêmes terrains fasse l’objet d’interdiction de la part des institutions. Après avoir rapidement contextualisé les facteurs d’augmentation et de diffusion de la violence au Mexique (activités de narcotrafic, contrôle territorial par les cartels et groupes armés, réponse des autorités depuis 2006 et leurs effets, extension des mondes socioéconomiques occultes…) L. Faret met en avant une double situation d’insécurité et d’exposition à la violence, celle à laquelle le chercheur est exposé sur le terrain, mais aussi et plus directement celle subie de façon continue par les populations migrantes en situation de marginalité et de vulnérabilité, très exposées par ailleurs aux effets de l’impunité marquée que l’on rencontre dans les périphéries métropolitaines. L. Faret met l’accent sur l’accès rendu difficile à des populations en situation de défiance et d’invisibilité alors que la violence est elle- même invisibilisée par les autorités, voire même produite par elles : la pratique de tels terrains demande une organisation collective de la recherche, selon des rythmes particuliers, où l’accès à des informations circonstanciées sur le contexte est fondamental et demande des recoupements permanents. Se pose certes la question de la sécurité individuelle du chercheur et de ses informateurs, mais aussi celle du risque qu’il fait prendre à la population qu’il étudie par sa seule présence.
Bien que les contextes soient différents, ces deux interventions ont fait ressortir plusieurs éléments communs liés aux violences et aux risques : d’une part, la parole des chercheurs est contrôlée, au sens où le passage à l’écriture s’accompagne de formes d’autocensure, visant à ne pas mettre en péril autant les populations avec lesquelles le chercheur travaille, qu’à préserver les liens entre le chercheur et son terrain. L’autocensure comme les interdictions ou l’impossibilité d’accès au terrain participent de l’apparition de « trous de connaissance », c’est-à-dire de champs et de terrains de recherche sur lesquels des données et analyses ne sont plus disponibles, alors même que les processus en cours sont souvent très évolutifs et questionnent les régimes de stabilité sociale et politique des régions concernées.
La deuxième session était orientée sur l’analyse de situations de recherche ayant en commun d’être associées à des formes d’illégalité et/ou de contrôle, voire d’interdiction, de la part des autorités. Claire Duport, sociologue, a ainsi présenté ses travaux sur « Réseaux et acteurs de la drogue à Marseille et au-delà : approche en terrain sensible ». Interroger une activité illicite, ici le trafic et l’usage de drogues, conduit non pas à mettre en œuvre des méthodologies différentes, mais plutôt des manières de faire différentes. L’indicible et l’invisible apparaissent toujours au chercheur derrière un écran, l’obligeant à appréhender ce qu’on ne lit pas, ne voit pas, n’entend pas par des détours, notamment en posant que les acteurs de l’illicite ont aussi d’autres rôles et positions sociales qui peuvent être des portes d’entrée. Ces particularités participent de la construction d’un cadre moral « qui nous affecte et affecte la parole des acteurs » ; le rapport de décision de recherche s’en trouve inversé, c’est-à-dire que ce sont les acteurs eux-mêmes qui disent s’il faut partir ou non, qui construisent le rapport au terrain. C. Duport souligne aussi les questions du statut du chercheur et la nature des commanditaires de recherche : dans son cas, le cadre académique a souvent besoin d’être déplacé, et les conditions de recherche doivent se faire souples au grès de la demande de connaissances provenant d’acteurs très divers. Cette diversité des rôles présente à la fois contraintes et opportunités. C. Duport indique également, à partir de différents terrains mis en perspective, que la compréhension des systèmes criminels est paradoxalement plus difficile dans des contextes pacifiés. Les turbulences sont des facteurs pouvant aider à la compréhension.
Dans un contexte différent, celui de la gestion urbaine au Rwanda, Benjamin Michelon, socio-urbaniste, s’est attaché dans sa communication « Un urbaniste français au Rwanda : pratique d’experts et travail de recherche sous surveillance » à décrypter les manières de faire du terrain dans un contexte de terrain très contrôlé, voire interdit par les autorités. Le centralisme et la volonté de contrôle du pouvoir central sont des éléments extrêmement prégnants, d’autant plus quand on travaille sur une capitale-vitrine comme Kigali. L’interdiction d’accès au terrain relève moins de l’Europe (pas en zone rouge du MAE), mais est interdite par les autorités nationales. Un autre élément de contexte est lié au rôle de la France dans l’histoire récente du Rwanda, ce qui complique encore la construction de la légitimité à analyser des processus in situ. B. Michelon signale ici que son rattachement à une institution suisse était une situation lui offrant davantage de libertés et permettait de dépasser certains blocages. Il signale dans son intervention la contradiction d’autorisations de recherche qui sont refusées sur des questions que pourtant le gouvernement voudrait voir traitées. Plus largement, il signale le paradoxe d’un « pays ouvert, mais avec des sujets interdits ». Autre élément de tension, s’intéresser à la question du foncier, instrument de pouvoir et de magnificence du pouvoir central sur lequel il est très difficile d’obtenir des informations. Être sous observation des autorités oblige à négocier autrement les conditions de terrain, c’est-à-dire à articuler la réponse faite à la demande de recherche de la part de ces mêmes autorités avec des formes d’observation discrètes ou cachées, voire en abordant les vrais thèmes de la recherche par des chemins détournés.
La question du statut du chercheur a été posée dans les deux interventions avec en arrière-plan le rôle de « couverture » joué par certains types de statuts : celui d’expert pour une organisation internationale, celui de chercheur en situation précaire (contractuel, post-doctorant) ou celui d’étudiant par exemple. Le chercheur peut aussi faire varier les manières de se présenter dans le temps et selon les contextes, mais se pose alors sur le long terme la cohérence de la posture. S’interdire de dire qui l’on est, constitue aussi une alternative, qui questionne cependant l’éthique de la recherche et l’usage des informations ainsi obtenues. Dans ces contextes, se posent les questions de la légitimité de la présence du chercheur ainsi que de l’instrumentalisation possible de sa présence que ce soit de la part des autorités et/ou des acteurs de son terrain. Pour autant, l’engagement et l’instrumentalisation ne fonctionnent pas forcément en phase : on peut avoir une position distanciée et être instrumentalisé, on peut être dans une posture d’engagement et contourner les risques d’instrumentalisation. La séance pose également la question de « quoi écrire ? » à partir de ces matériaux de terrain : s’appuyer partiellement sur des rapports officiels d’institutions internationales peut permettre de rendre audibles des résultats de recherche selon Michelon.
La troisième session a tenté d’explorer la question de l’engagement du chercheur : engagement politique et social, mais aussi engagement sur le terrain. La première intervention de Maud Laëthier et Jhon Picard Byron portant sur « Affection orange. Pratique de terrain, objets sensibles en Haïti » a cherché à explorer la situation particulière d’Haïti, espace marqué par la violence, l’imprévisibilité des formes de violences et la pénétration du tissu social par le sentiment de danger. Cet état de fait, qui traverse l’ensemble de la société haïtienne, rejaillit autant sur les conditions de la recherche que sur les thématiques. Du point de vue méthodologique, M. Laëthier indique que le travail sur la mémoire de la violence ne permet pas, par exemple, d’utiliser des outils tels que l’entretien biographique, obligeant le chercheur à se tourner vers des outils plus informels tels que l’observation et la conversation informelle, associées à une présence de longue durée sur le terrain. Mais les situations de violence multiformes dans la durée peuvent aussi affecter le chercheur dans sa pratique comme dans sa condition psychique, facteur qu’il doit nécessairement appréhender. Se pose aussi la question dans cet espace de la position différente entre chercheurs étrangers et chercheurs nationaux. Ces derniers sont embarqués dans des contextes politiques et institutionnels, conduisant à effectuer un travail de mémoire sur les liens entre le politique (et notamment les héritages de la dictature) et l’institution universitaire. L’anthropologie est alors devenue en elle-même un objet sensible, dans un contexte de surpolitisation et de violence à l’université. Le cas d’une collaboration institutionnalisée entre France, Haïti et Cuba et l’accueil de JP Byron à Paris peuvent aussi être lus comme un positionnement politique pour certaines autorités haïtiennes, avec éventuellement des effets futurs sur l’accès au terrain. JP Byron souligne que le choix d’un thème de recherche (l’histoire de l’ethnologie) est en soi une posture sensible, notamment lorsque les chercheurs questionnent l’oubli de l’ethnologie dans les années 1980 et l’instrumentalisation des travaux des ethnologues par la dictature Duvalier.
L’intervention de Daniel Senovilla, « Se positionner sur un terrain délicat : le rôle du chercheur auprès des mineurs migrants non accompagnés », pose également la question de l’engagement du chercheur en lien avec les dimensions éthiques et épistémologiques posées par la vulnérabilité du public concerné par le terrain, à savoir les mineurs migrants non accompagnés. D. Senovilla s’est interrogé sur l’écart entre la norme, notamment juridique, et la réalité de l’application du droit ou le rapport entre la population mineure et l’institution. Face à des populations qui sont prises entre des questionnements répétés des acteurs (de l’administration et/ou des chercheurs) et leur position d’altérité, les outils méthodologiques doivent être adaptés (informalité, atelier de parole, moments ludiques…). Le terrain s’effectue via la médiation des institutions de prise en charge de ces jeunes, ce qui oblige à réfléchir à la gestion des affections dans le quotidien avec eux, d’autant plus dans un contexte d’incapacité des mêmes institutions d’accompagner ces jeunes. L’accès au terrain passant par une négociation en amont avec les associations et institutions (longue et compliquée), cela pose des limites à la possibilité de rendre compte des pratiques et dysfonctionnements des institutions : le terrain peut se fermer. Pour ces mineurs migrants non accompagnés, les chercheurs peuvent aussi devenir des personnes-ressources, ce qui n’est pas sans poser des questions éthiques ou déontologiques. Le chercheur peut ainsi être conduit à faire un « premier tri » arbitraire, pour choisir de s’engager en premier lieu vers les plus vulnérables. Les questions de délégitimisation du travail sont aussi abordées, notamment de la part des institutions au moment de la restitution des résultats.
Ainsi, la question de la frontière entre l’engagement et la recherche s’est trouvée au cours de cette session : elle met en jeu le statut différent du chercheur sur son terrain et vis-à-vis de l’environnement (scientifique, institutionnel ou affectif) dans lequel il évolue, selon qui il est, mais aussi sa capacité à transformer ou non le fait « d’être affecté » (Favret-Saada) en une forme d’engagement. La frontière entre distance et implication est diffuse, comment jongler avec les nombreux intérêts politiques, les positionnements des acteurs institutionnels et leur évolution, objectiver son travail dans des environnements extrêmement politisés ?
La journée s’est clôturée par une table ronde réunissant Florence Boyer, Denis Vidal et Marc- Antoine Pérouse de Montclos. Cette table ronde a été conçue comme une synthèse et une ouverture à d’autres journées de réflexion futures.
Différents points sont ainsi ressortis :
- le point d’interrogation du titre de la journée était justifié : il faut décliner les formes de « l’interdit », c’est loin d’être partout pareil sur « qui produit de l’interdit ? ». Loin d’être toujours l’institution d’appartenance du chercheur, même si c’est l’entrée que la journée a souhaité mettre en Pas toujours non plus l’autorité publique (à ces différents niveaux) en charge des régulations. Parfois ce sont les tensions internes aux processus étudiés et aux environnements socioéconomiques ou politiques dans lesquels ils s’inscrivent qui génèrent les contraintes et blocages à leur approche.
- le rapport aux institutions (prises au sens large : État, administrations, associations…) est variable selon les L’institution autorise, rend possible des choses, en interdit d’autres, en rend certaines impossibles aussi, sans pour autant les interdire : il y a un jeu entre interdit/autorisé et possible/impossible qui est transversal, même s’il n’est pas transposable. Cette construction du rapport à l’institution est toujours un état variable.
- Il a été peu question de changement de terrains ou de méthodologiques. Plutôt, on fait appel à d’autres manières de les mettre en œuvre, à d’autres personnes-ressources. Changement du rapport avec les personnes avec qui on On a accès à une parole qui est décontextualisée. Car celui qui transmet une parole est là où on peut la recueillir, à défaut de là où elle devrait être recueillie. De ce point de vue, la journée a beaucoup interrogé la « vérité », la question d’une parole légitime à laquelle on peut accorder du crédit. C’est sans doute propre à des contextes où le croisement des données est plus compliqué, reste lacunaire du fait des limites d’accès.
- Dans les situations présentées, des couples d’opposition sont interrogés autrement : visible/ invisible, licite/ illicite, prévisible/ imprévisible, interdit/ autorisé, possible/ C’est classique en sciences sociales, mais ici les dichotomies peuvent être plus incertaines encore, car les limites sont fluctuantes. Le chercheur est suspendu à des couperets, à des risques que des situations se dégradent. La temporalité de mise en œuvre des dispositifs est différente.
- Interdictions ou impossibilité d’accès au terrain participent de l’apparition de « trous de connaissance » : données et analyses ne sont plus disponibles, alors même que les processus en cours sont souvent à fort Ces trous de connaissance sont à mettre en lien avec des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Contradiction relevée entre demande de connaissance du terrain et obstacles à les pratiquer, une sollicitation par des institutions qui en même temps rendent impossible l’accès. Pose le problème de comment parler quand les dispositifs de la recherche ne sont plus mis en œuvre ? Comment les temporalités jouent sur une possible « légitimité décroissante » du chercheur?
- La responsabilité du chercheur vis-à-vis des questions de dangerosité/accessibilité est à différents L’enseignant- chercheur qui encadre des étudiants a lui-même une fonction de prescripteur, comment la met-il en œuvre ? Le vrai souci est juridique et d’assurance : tant que tout va bien on ferme les yeux?
- La question du partenariat avec les collègues ne se pose pas de la même façon quand l’accès au terrain est délicat, mais en tient-on compte dans la mise en œuvre de la collaboration ? La dimension politique du lien construction de l’objet – construction du partenariat est très rarement posée en tant que
- Le chercheur comme témoin malgré soi: si le chercheur est preneur de décision sur ce qu’il va faire, où il va aller… il n’en reste pas moins qu’il est dans une situation particulière de par son métier et de par la relation de confiance qui est en Plus que le risque même, une question à poser est que fait-on, en tant que chercheur, de ce que l’on n’est pas censé voir ? Une situation de violence affecte au-delà des parties prenantes, en rendre compte affecte aussi plus largement les sociétés locales.
- La question des temporalités de la violence: pour un chercheur, il ne sert à rien d’assister à des faits de violence en tant que tel, par contre il est nécessaire d’être là avant ou après, ou mieux encore avant et après. Être un témoin est différent de faire une Le chercheur peut avoir un rôle de « briseur de silences », facilité par le fait qu’il bénéficie d’une extériorité, mais ce n’est pas dans la situation de violence elle-même qu’il peut pratiquer son activité scientifique.
- La question de la construction des règles de sécurité: certes, la nature et le sujet de recherche conditionnent l’enquête et l’accès au terrain, celui-ci dépendant aussi du statut, de l’âge, du genre, de la nationalité… Le commanditaire de la recherche peut être important, dans la mesure où il conditionne aussi, voire impose, les règles de sécurité. La définition des zones par le ministère des Affaires étrangères en France obéit à des logiques qui sont aussi géostratégiques, c’est-à-dire que des terrains peuvent être interdits sans être dangereux, et d’autres, dangereux et autorisés. Les chercheurs peuvent alors se retrouver dans la contradiction entre une demande de recherche et une interdiction des conditions de production de cette même
- La nature et le sujet de recherche déterminent beaucoup de choses: travailler sur la violence ou en contexte de violence, ce n’est pas la même
- Le besoin d’un débat avec les institutions dont dépendent les chercheurs apparaît nécessaire, car le montage de partenariats, par exemple, ne peut pas se faire sans prendre en compte les effets de contraintes plus ou moins fortes, plus ou moins durables ou plus ou moins politiques des questions de l’accès au terrain.
Florence Boyer et Laurent Faret
Programme
Journée d’Études F3S, 11 septembre 2017, organisée par CESSMA et URMIS
Salle M19 – Univ. Paris-Diderot – Bât. Olympe de Gouges – Accès libre
Les pratiques de la recherche scientifique ne peuvent faire l’économie d’une démarche réflexive sur la construction du savoir et les conditions dans lesquelles celui-ci est élaboré. En sciences sociales, l’accès au terrain est la condition sine qua non d’une production historicisée et située de connaissances au plus près des transformations sociales. Un ensemble de restrictions affecte aujourd’hui, de façon inédite, la possibilité de mener librement un travail de recherche fondé sur une approche empirique des objets.
Sur la base d’un partage d’expériences, cette journée vise à engager une réflexion sur les conséquences de ces restrictions et limitations (définies par les institutions ou des intérêts géostratégiques) autant dans le choix des objets que dans la production des connaissances.
– 9h30
Mot d’accueil F3S
Présentation de la journée d’études. Florence Boyer et Laurent Faret
– 10h00
Perdre le Nord… du Mali sans couper les liens avec les gens qui y vivent. Retour sur cinq années de violences et de terrains interdits.
Charles Grémont (IRD, LPED)
– 10h30
Terrains mexicains en contexte de violences : migrants centraméricains dans l’espace métropolitain.
Laurent Faret (Univ. Paris-Diderot, CESSMA)
– 11h45
Réseaux et acteurs de la drogue à Marseille et au-delà : approche en terrain sensible.
Claire Duport (Transverscité, Université Aix-Marseille)
– 12h15
Un urbaniste français au Rwanda : pratique d’experts et travail de recherche sous surveillance.
Benjamin Michelon (Groupe Huit)
– 14h30
Affection orange. Pratique de terrain, objets sensibles en Haïti.
Jhon Picard Byron (Faculté d’Ethnologie, Univ. d’État d’Haïti) &
Maud Laëthier (IRD, URMIS)
– 15h00
Se positionner sur un terrain délicat: le rôle du chercheur auprès des mineurs migrants non accompagnés.
Daniel Senovilla (CNRS, Migrinter)
– 16h-17h30
Table ronde finale : animée par Florence Boyer (IRD, URMIS)
Véronique Dupont (directrice-adjointe CESSMA)
Représentant de l’IRD
Pierre Boilley, GIS Afrique (sous réserve)
Marc-Antoine Pérouse de Montclos (CEPED, IRD)